Epidémiologie et facteurs de risques
Le cancer de l'estomac, également appelé cancer gastrique, est une maladie qui touche les cellules de la paroi de l'estomac. En 2020, selon les données de l'OMS, environ 1,09 million de nouveaux cas ont été diagnostiqués dans le monde. Il est plus fréquent chez les personnes de plus de 60 ans, et les hommes sont plus susceptibles d'être affectés que les femmes.
Les principaux facteurs de risques incluent une infection par la bactérie Helicobacter pylori, la consommation excessive de sel et de produits alimentaires conservés, le tabagisme, et des antécédents familiaux de cancer de l'estomac.
Dans la majorité des cas, le cancer de l’estomac apparait sur un terrain de gastrite (inflammation de l’estomac) ou d’ulcère de l’estomac ne cicatrisant pas.
Il s’agit le plus souvent d’un Adénocarcinome gastrique, dont le point de départ est la muqueuse de l’estomac.
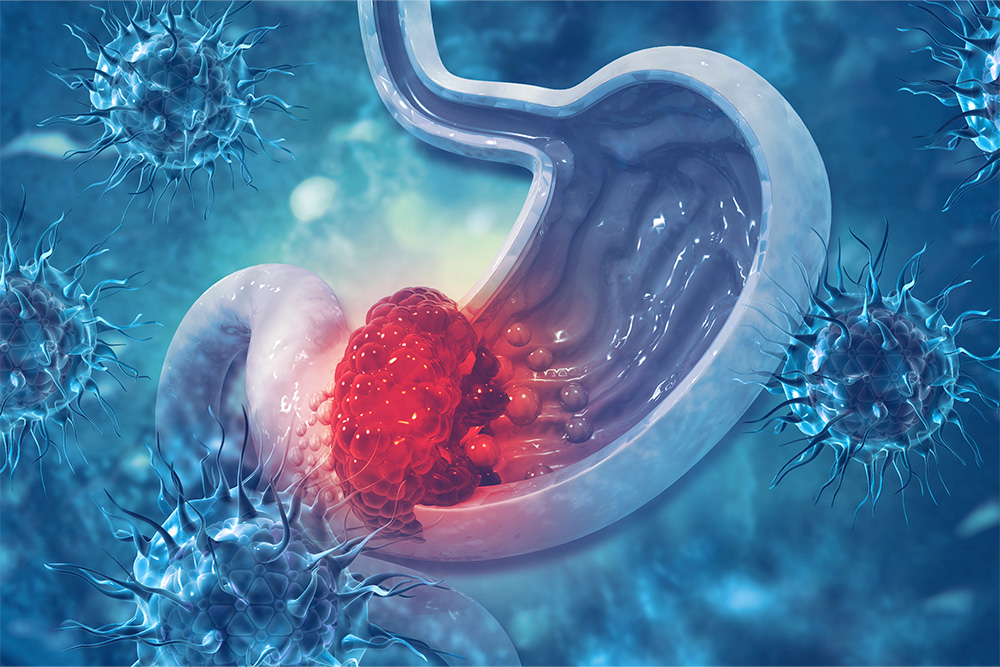

Rappels anatomiques
L’estomac est un organe creux du tractus digestif supérieur, situé dans la cavité péritonéale.
Celui-ci est placé entre l’œsophage et le duodénum, avec le cardia (du côté de l’œsophage) et le pylore (du côté duodénal) comme sphincters lui permettant d’être continent.
L’estomac est divisé en trois parties : le fundus, qui correspond à une poche supérieure, le corps, qui est la partie médiane, et l’antre, qui est la partie distale de l’estomac.
L’estomac reçoit directement les aliments et y entame la digestion en générant le bol alimentaire, mélange des aliments qui est transmis ultérieurement au duodénum et à l’intestin grêle.
Bilan d'extension
Au diagnostic d’un cancer gastrique, on réalise un bilan d’extension qui permet de déterminer le stade de la pathologie, les thérapeutiques les plus adaptées et d’éventuelles atteintes associées.
Pour les cancers de l’estomac, le bilan comprend :
- un scanner thoraco-abdomino-pelvien : cette imagerie permet parfois de voir la lésion et ses conséquences (occlusion ou pré-occlusion) et de repérer d’éventuelles lésions secondaires (ou métastases) au niveau des poumons ou du foie.
- +/- une écho-endoscopie gastro-duodénale, en particulier en cas de suspicion de linite gastrique, examen qui permet de confirmer ce type d’atteinte,
- +/- une IRM hépatique en cas de lésion hépatique ou de doute sur une lésion hépatique : l’IRM hépatique permet, avec des arguments différents du scanner, de caractériser des lésions hépatiques,
- +/- une coelioscopie exploratrice, dont l’objectif est double : éliminer une éventuelle carcinose et confirmer la résécabilité de la lésion,
- +/- les marqueurs tumoraux (ACE, CA 19-9) qui, sans faire partie du bilan d’extension, peuvent parfois faciliter le suivi.

Les différents traitements
Les traitements sont proposés et mis en route au décours de la présentation en RCP et après accord du patient.
Pour les lésions les plus précoces et dans certaines conditions spécifiques, le traitement endoscopique (la résection lors d’une fibroscopie) peut être suffisant.
Pour les lésions plus évoluées, la chirurgie et les traitements systémiques jouent des rôles différents.
La chirurgie peut être proposée dans deux situations distinctes : dans le cadre d’un projet curatif où elle est alors réalisée selon certaines règles (avec des marges de sécurité et un curage ganglionnaire défini) ou dans le cadre d’une tumeur symptomatique (occlusion, saignement, voire perforation) où la chirurgie traite avant tout le symptôme.
En fonction de la taille de la lésion, des antécédents du patient, de l’expérience du chirurgien et du contexte (urgence ou chirurgie à froid), ces opérations peuvent être réalisées sous coelioscopie (chirurgie mini-invasive) ou à ciel ouvert. On parle de gastrectomie totale, de gastrectomie des 4/5ème ou de gastrectomie atypique.
Les traitements systémiques, la chimiothérapie et l’immunothérapie, ont une place importante dans le cadre du cancer de l’estomac qui est une maladie à développement lymphophile. Dans le cadre des traitements curatifs, Ils visent à limiter le risque de récidive et sont souvent préconisés avant une intervention chirurgicale (en fonction du bilan d’extension) ou après celle-ci (en fonction de l’analyse de la pièce opératoire). Enfin, ils dans des contextes non-curatifs, ils visent à contrôler la maladie.
La radiothérapie peut être utilisée après intervention chirurgicale dans certains protocoles ou, dans le cadre de lésions qui saignent, de façon à réaliser une hémostase sans chirurgie.


